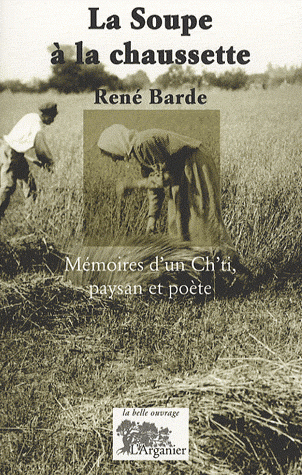| |
"On charriait le foin le matin où je suis né.
Ce jour là se produisit une perturbation peut être énigmatique, mais sûrement imputable à mon arrivée à la ferme des parents: on mangea de la soupe à la chaussette ! Il en était une qui avec d’autres séchait au-dessus du fourneau, perdant l’équilibre, elle tomba dans la marmite. On ne s’en aperçut que lorsqu’elle fut servie dans une assiette après deux heures de gros bouillon avec le lard et les légumes.
Peut-être faudra-t-il en reparler de cette chaussette de laine qui mit de la dérision dans un paisible repas d’ouvriers. Je crois que les poils ne leur en sont jamais sortis d’entre les dents, car les miens, diront de moi toute leur vie :
_“Celui-là, rien de bon . Il va tout à rebours. Il fait son dévot, il fume, ne veut pas travailler et préfère se passer de manger que d’avaler un morceau de lard. Une tête de bois... Devenu en âge toujours plus fainéant, il se met à écrire des livres et ne veut pas gagner d’argent. Et quand tout le monde se rase, lui, lui seul, laisse pousser toute sa barbe. Une tête de bois, une tête de bois.”
Ainsi disait-on sur le sixième et dernier né que je suis. Et si les poules en me voyant ne chantaient pas le coq, on interprétait çà comme l’annonce d’un malheur, qu’il fallait conjurer en leur tordant le cou.
Tout jeune, très jeune, j’avais la pauvreté en horreur. De voir la grange pleine de blé, les étables pleines de bétail, me rassurait. Je me disais les mains calées au fond des poches, “quelle chance j’ai eu de naître chez des paysans qui ne sont pas des pauvres.” Les familles de mineurs - il y avait des mines dans le pays - n’ont ni vaches, ni chevaux, ni froment.” Je m’estimais un favori de l’existence. Par exemple dans la famille Billet, ils étaient six enfants pour un petit salaire de menuisier. Ils ramassaient pour les manger les poules crevées jetées depuis huit jours dans les haies. Ils étaient gais et vifs comme tous les êtres jeunes, mais n’étaient point solides. Je n’étais pas né non plus comme les enfants de Séraphine, la veuve, s’ils voulaient des poires ou des pommes ils devaient, à tout risque pour eux, aller les marauder chez les autres.
Mais bientôt ce que j’appelais ma chance allait se retourner contre moi, car je m’aperçus que les fils de mineurs buvaient du lait complet, tandis que le mien était écrémé; qu'ils mangeaient du beurre plus que moi, et avaient autant de tartines qu’ils leur en fallait, qu'on ne les écœuraient pas avec du lard, mais mangeaient le bifteck de la boucherie.
À la maison tout le monde aimait le lard, sauf moi. Je ne pouvais pas l’avaler. Cela à la longue allait avoir une influence désolante et décisive sur mon avenir; car le lard, que je ne pouvais pas me mettre dans le corps, étant le produit de la ferme, on ne le remplaçait par rien, car on n’était ni riche, ni aisé et il fallait chez nous vivre le plus possible de ses produits. Ma sœur, qui était l’ainée, d’énervement me barbouillait parfois le visage de la tranche qu’on avait mise dans mon assiette. De sorte que sans en avoir l’air, sans que personne s’en doutât, - ils ne le savent pas encore après 50 ans : “On mangeait bien à la maison” disent-ils - j’allais devenir un sous-alimenté de jeunesse - ce qui en est une des pires formes - et avec tous les inconvénients que cela comporte à la longue.Les seaux de lait, les mottes de beurre, les sacs de blé, tout cela n’était pas pour moi, mais pour vendre et faire face à tout un monde de propriétaires, un monde de percepteurs d’impôts, de forgerons, de bourreliers, de charrons qu’il fallait payer.
Quant aux autres, ils étaient capables de faire des prouesses de tous genres, et d’abord à table . Quand on tuait un porc, ma mère mangeait un kilo et demi de côtelettes pour son souper. Elle pouvait substituer à cela un kilo de fromage quand l’occasion s’y prêtait. Mon père, il portait une poêle et une cafetière dessus par le bout du manche serré entre les dents... Avec les siens, mon frère Honoré soulevait et portait plus de quatre-vingt-quinze kilos. J’avais une tante qui à seize ans montait cent kilos sur son dos de la cour au grenier.
En plus de son propre poids, mon frère Honoré soulevait et portait plus de quatre-vingt-quinze kilos. Il pouvait manger une terrine de pâté que ma tête n’aurait pas remplie. Quand on faisait des crêpes il fallait le chasser, et pour éviter cet embarras on n’en faisait jamais. Il était à-peu-près de la mesure d’un de nos cousins qui, après avoir dîner pouvait encore manger deux kilos de pâté et quatorze tartines.
Marc tenait bien la fourchette aussi, mais surtout l’aimable dieu Éros l’avait pourvu de qualité, c’est peut-être pourquoi tout le monde l’aimait. Et tous ces gens y compris Ovide le quatrième étaient capables après le travail du jour de redoubler la nuit.
Plus tard, jamais personne ne voudra travailler avec Ovide : ni son fils, ni son gendre, ni ses compagnons, et c’est avec un tel collègue qu’on allait m’atteler comme sous-verge.
Nos parents avaient voulu du bétail, des champs, des prairies, des enfants pour les y mettre à travailler. À sept et neuf ans mes aînés devaient le matin conduire les vaches au pré à trois kilomètres de l’école où ils arrivaient crottés jusqu’aux genoux. Et le soir ils devaient les y reprendre. S’ils voulaient jouer comme tous les enfants, ils devaient faire de leur travail des jeux. Cela leur fit à la longue des tempéraments de jeunes loups. “Des leups, des leups” disait ma mère en patois.
Un jour une de nos tantes leur reprocha vertement qu’une des vaches avait arraché une betterave à son champ. Le gamin, Marc, de près ne répondit point, mais de loin il cria à la tante:
_ “je t’emmerde... vieille vache toi-même”.
Dire cela à leur tante! Notre père nous recommandait bien de nous battre avec ceux du dehors, de ne jamais pleurer et de boire beaucoup de bière, mais pas d’appeler ses sœurs du nom des braves bêtes qu’ils avaient à garder. Aussi quand il apprenait ces choses, le soir les coupables allaient à genoux dans le coin après avoir reçu un coup de casquette. “C’est des leups” appuyait ma mère.
À la maison on n‘extériorisait pas les sentiments. On n’embrassait jamais les parents sauf au Nouvel An. Une fois seulement, je crois que les lèvres de ma mère ont effleuré mes cheveux. Père n’embrassait jamais notre mère, du moins devant nous. Parfois à la nuance d’un mot ou d’une phrase plus adoucie, on pouvait déceler une vague tendresse. Mais cela on peut aussi le constater à l’oeil des animaux de trait, bien qu’on n’entende pas ce qu’ils disent.
Je n’ai pas eu une enfance aussi rude que mes ainés. Je suivais les garçons à huit, cinq et trois ans de distance. Si nos parents ne nous frappaient pour ainsi dire jamais, mes frères, eux, ne manquaient aucune occasion de me brutaliser, de me faire des grimaces ou de "raconter" contre moi. Ma soeur, elle même, me giflait volontiers. À dix-huit ans encore ils me rebutaient de toutes sortes de mauvaises paroles. Ce n’est qu’à l’âge d’homme qu’ils en agirent un peu mieux. Marc, celui que pourtant tout le monde aimait, était peut-être le pire. Pour un rien, il me laissait parfois à demi-évanoui sur le carreau pour m’avoir trop battu. Il éprouvait, j’en suis sûr un plaisir charnel à faire du mal.
Je reconnais que j’étais toujours mal fagoté, mes maigres mollets dans des bas rudement raccommodés, ma tignasse blonde, mes deux grandes dents qu’on appelait “pelles à bran”, tout cela n’était point trop fait pour plaire et leur constitue peut-être une vague excuse...
|
|